retour à la page d'accueil
Le jour des écureuils, tiré d' Au revoir collines verdoyantes
de Gabriel René Franjou
Dans le noir j’ai les yeux grands ouverts depuis des heures. Allongé nu sur ma housse sans couette parce que la température n’a pas baissé de la nuit, j’attends le lever du jour et le retour de Charlie. Mon téléphone est mort, et il n’est toujours pas possible de le charger. L’électricité ne fonctionne plus dans tout le quartier, peut-être toute la ville. L’icône en rotation sur la page autrement blanche de mon ordinateur a continué sa révolution jusqu’à ce que l’appareil, vidé, s’éteigne avec un bruit austère. Quand je jette de temps en temps des petits coups d’œil rapides à l’écran encore relevé, l’image du chargement s’y imprime et je détourne le regard avant de me laisser le temps de correctement distinguer mon reflet. Les yeux de nouveau rivés sur le plafond, l’icône persiste au fond de mon crâne, et toujours, rien ne vient.
La nuit faiblit. Elle est chaude et bruyante et longue dans ses dernières heures. Il y a eu de l’agitation dans les rues, les chants les hurlements, la joie et la panique, les crashs et quelques sirènes. Je pense qu’un attroupement massif a dû passer par le voisinage. J’ai entendu un hélicoptère voler très bas, et je me suis demandé si j’étais déjà monté dans un hélicoptère (je ne suis pas certain). Sous un manteau d’obscurité et sans courant, la ville semble s’être libérée – mais aucune visualisation, aucune scène ne me vient. J’espère ne pas trop m’inquiéter pour mes amix mais je m’inquiète quand même un peu. J’espère que Bliss et son amie sont rentrées saines et sauves. L’alcool que j’ai bu cette nuit m’a laissé le ventre contrarié, mais malgré tout, je me sens calme, apaisé, et franchement seul. La sueur me plaque les poils de jambe, je ne bouge plus depuis longtemps. Je ne sais pas quelle heure il est, je n’ai pas de montre.
Je m’attendais à voir la lumière invasive des lampadaires, récemment convertis du gaz à l’électrique, emplir ma chambre avant que ne pointe l’aube, mais ce ne sera pas pour aujourd’hui. L’annonce du retour du jour, le noir fondant au bleu, me rappelle au temps, et après un dernier coup d’œil futile vers mon écran, je ferme méthodiquement les yeux. Quand enfin l’image de la sphère tournant sur elle-même s’efface de mon esprit, quand je commence à sentir mon corps s’enfoncer dans mes draps bleu ciel, alors le blanc se remplit d’une lumière chaude, vive. J’entends une clé tourner dans la serrure industrielle de l’appartement. Entre des éclats de rires essoufflés, Charlie hurle ALLES GUT – quand la porte claque je sens le coin de mes lèvres légèrement remonter et je m’endors comme à chaque fois bercé par l’image des flammes qui brûlent à l’autre bout du monde, et c’est comme si elles avaient toujours été là.

Je dors peu, le jour me dérange. Je ne m’attarde pas trop au lit, et en me levant, j’appuie sans espoir sur l’interrupteur, haut-bas-haut-bas. Inutile. Je tente d’allumer l’ordinateur, qui ne réagit pas non plus. Une montée de panique aiguisée me reste dans la gorge ; elle passe vite. Je me faufile sur la pointe des pieds dans l’espace commun. Katja et Idris, et Charlie et Shen (Shen est l’une des amantes de Charlie) dorment toustes sur le canapé ou aux alentours. Je reste un petit moment à les regarder, debout en me positionnant exprès pour que les rayons de soleil frappent ma nuque. Quelle vie, je me dis. Je décide de leur cuisiner des œufs brouillés, mais en ouvrant le placard pour attraper une poêle je renverse tout et je les réveille. De toute façon la cuisinière ne fonctionne pas non plus. Au final, c’est Idris qui prépare le petit-déjeuner.
Je sers du jus de fruit – tiède – à tout le monde et mes amix me racontent leur nuit. Quand le son s’est subitement éteint dans le club, Charlie a continué à danser, mais Katja et Idris ont senti que quelque chose n’allait plus. Dans l’obscurité totale, le désarroi a vite gagné les animaux nocturnes quand iels se sont rendu compte qu’iels ne captaient plus de réseau sur leurs téléphones. Les gens forcés à quitter les différents clubs se sont retrouvés dehors, défoncés et interloqués, et plusieurs petits groupes surexcités se sont formés. Idris a été absorbé par et s’est perdu dans l’un d’eux, Charlie a croisé Shen ; assez vite, la Polizei a encerclé un groupe de festifs rassemblés dans l’inquiétant terrain vague aux alentours de cet amas de clubs. Idris, Antoine et deux trois autres ont été retrouvés plus tard plus loin devant Treptower Park. Ils étaient aux côtés d’au moins trois blessés, dont l’un qui saignait profusément de l’arcade sourcilière et un autre qui disait avoir deux orteils brisés. Du parc en question émanait une aura de chaos total, dionysiaque, chthonien, raconte Charlie, les yeux scintillants.
Le récit du reste de leur soirée, je ne l’écoute que d’une oreille ; en suivant le doigt pointé d’Idris jusqu’à un coin de l’appartement je découvre quelques modestes trophées : trois caméras de surveillance arrachées, une lumière de chantier, et un tas de roses déjà fanées (Shen a un pétale encore pris dans ses longues boucles noires et Charlie une infime incision au pouce). Je prends avec ma dernière gorgée de jus trois pilules : zinc, vitamine C, et mon médicament. Les verres sont vidés, l’histoire est terminée, mes amix sont sains et saufs. Je me lève de ma chaise, sans raison particulière. Petit silence. Je leur dis que pour ma part, je suis resté immobile dans mon lit toute la nuit. Je ne pose aucune question sur Bliss. À l’unanimité, nous décidons de passer la journée dehors et de profiter du bordel du soleil de la liberté. Détox, baby, détox, me dit Charlie ; KEIN INTERNET, ajoute Katja. Pas le choix, je réponds. Je suis prêt.
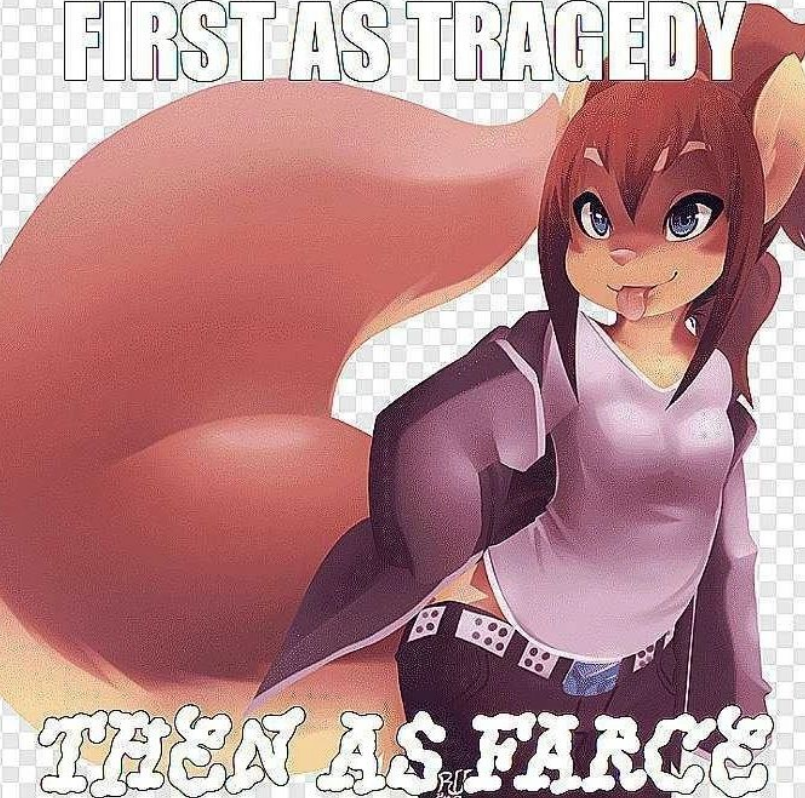
Au bout de sa redescente vers l’asphalte ma semelle écrase un énorme tesson de verre. Le bruit me fait peur mais je ne me suis pas fait mal. On court, on fuit le nuage de lacrymo et on rigole bruyamment ; on s’entend à peine au-dessus du bruit ambiant. Les gens sont en joie et la Polizei commence à s’énerver. C’est le soir, il fait encore jour, et tout le monde est dans la rue. Les vitrines de Mitte ont volé en éclat la nuit passée et les débris jonchent le sol, c’est le jour le plus chaud de l’année, ça sent le caoutchouc fondu et la crème solaire. On s’est bien amusé. On en a assez maintenant, et l’on raconte que l’armée était arrivée dans certains quartiers. Alors on rentre.
Une fois éloigné·e·s du chaos urbain, on se regarde toustes, pour s’assurer que tout le monde est là et que tout le monde va bien. Toustes habillé·e·s de noir (au cas où), le dos trempé, mais indemnes, on se prend dans les bras et l’odeur de nos sueurs nous chatouille. On rigole, on tousse, Idris a les yeux et les joues humides (il s’approche toujours trop près). Ici au centre, la Polizei monte la garde devant les magasins et les banques, et nous étions à un rassemblement pas loin d’Alexanderplatz où un groupe de jeunes slaves chantaient et distribuaient de la nourriture et de l’eau. Il y a vingt minutes on a vu un ensemble d’enthousiastes déguisé·e·s en animaux qui couraient et hurlaient dans les rues, et cinq minutes plus tard la Polizei a chargé et voilà, on a fui. Je me dis, absurde, tout cet accoutrement, par cette chaleur, les bottes, le casque, cette armure. Et puis cet entrain dans la violence, cet excès de zèle sous ce soleil, comment est-ce possible ? Les festivités touchent à leurs fins. On rentre, lentement, en traînant des pieds, malgré le speed que prennent Katja et Idris en plongeant leur clé dans un invraisemblable pochon en plastique vert. Charlie et Shen, elles, tournent encore à l’amphétamine de qualité pharmaceutique que le jumeau de Shen sait se procurer sur le web – elle offre une sensation plus propre et moins intense. Le chemin est long, vraiment long mais pas désagréable pour autant, et je semble flotter. Je me sens léger sans le poids de mon téléphone pour occuper ma poche (je l’ai laissé à la maison exprès), sans mes clés aussi (elles, je les ai oubliées).
On traverse la ville sale, plus sale que jamais (canettes vides, liquides mystère, flyers fluorescents, et ainsi de suite). On croise des groupes d’adolescent·e·s maquillé·e·s avec expertise et délibérément détendu·e·s, des familles promenant leurs enfants, un SUV Mercedes rongé par d’hésitantes flammes, un couple de cinquantenaires en lunettes de soleil assorties se tenant la main, une quantité notable de graffitis encore dégoulinants, des chiens difformes jouant à se battre, un arbuste déraciné (pincement au cœur). Certain·e·s riverain·e·s ont installé devant chez elleux des stands de rechargement à l’aide de générateurs de secours. Les quelques antennes de relais satellite installées en ville sont toutes hors-service – on ne sait pas ce qui s’est passé, mais cela ressemble à du sabotage. Si l’atmosphère paraît moins épaisse, allégée de son brouillard électromagnétique, l’air reste saturé d’odeurs agressives exacerbées par le soleil : la capsaïcine des lacrymos, les divers composés organiques volatiles de la peinture en aérosol, les ordures, le caoutchouc fondu toujours, et de vagues effluves de chaire carbonisée. Les habitant·e·s observent l’agitation depuis leur balcon, sirotant bières ou, plus rarement, du vin. Les lampadaires sont tous éteints. Je me demande si le Sénat de Berlin a ici aussi déjà achevé la reconversion des lampes à gaz historiques en électrique. Je me demande si, à l’heure qu’il y est, à cette période de l’année, ils devraient être allumés.
Au pied des tilleuls de Kreuzberg quantité d’objets, de détritus ou d’artefacts perdus ont été déposés, formant des tas hybrides et absurdes. Les gens continuent d’y prendre et laisser des trucs, dans un va-et-vient calme mais constant. Les tas ne réduisent jamais. Je reconnais les contours, mais je suis incapable de nommer un seul objet. Une masse informe, une bouillie de signes ; et je me dis, de nouveau, comme tous les jours : le monde est plein d’objets, plus ou moins intéressants, je ne souhaite pas en ajouter davantage. Mais je m’extrais de la trajectoire de notre groupe pour aller déposer sur un des tas la bouteille en verre, vide, qui contenait la boisson trop sucrée que j’ai bue trop vite. Un rayon de soleil (le soleil bas dans le ciel maintenant) atteint ma pupille et au pied de l’amas, l’intermédiaire qui reflète la lumière, seul objet autour de moi qui m’apparaisse définissable : une caméra de surveillance, immaculée, et dont les câbles ont été soigneusement sectionnés. Je la ramasse et retourne vers mes amix en la serrant contre ma poitrine, croisant Katja qui elle, en grognant, ramasse ma bouteille en verre et va la déposer de l’autre côté de la rue au pied d’une poubelle qui déborde déjà. Je leur dis : pour votre collection, iels rigolent, j’ai l’impression d’aider. C’est plutôt plaisant d’avoir passé la journée entière dehors. Je me souviens m’être dit, hier soir, que la nuit serait spéciale ; elle a dû infuser ses promesses à la journée d’aujourd’hui : une journée spéciale. Je me demande si cela ne tient qu’à l’absence d’internet, puis je me dis que je ne serai tout de même pas fâché de retrouver le réseau. Et je me dis qu’on peut aussi passer des journées spéciales sur internet. Faut bien y croire, puisque c’est ma vie. Quelle vie, je me dis. Shen dit qui veut du speed ? Personne n’en a envie, cette fois. Une bouteille d’eau circule entre nous, la chaleur fait son effet. Je bois par petites gorgées, comme on me l’a appris.
Un bruit de moteur, anormal, nous fait tourner la tête. Les promeneurs se taisent, quittent la rue pour rejoindre le trottoir, et le grondement de l’énorme 4X4 militaire qui descend lentement l’avenue emplit le soir. Les jeunes soldats qui l’occupent, bronzés, rasés, boutonneux, fixent tour à tour chaque personne qu’ils dépassent. Ils agrippent leurs armes. Les pneus du côté droit laissent derrière eux une mince coulée brune, qui pourrait aussi bien être de la boue, de la merde ou du sang. L’odeur d’essence, surpuissante, me donne la nausée. Le véhicule roule si lentement qu’il semble parader sur un tapis roulant, le genre qu’on voit dans les couloirs d’aéroports ; ça lui confère une aura solennelle mais brutale, qui suinte l’autorité. Tout à fait l’idée que je me fais de tout ce qui concerne le domaine militaire. En un instant trop étiré, le 4X4 rétrécit au fond de la perspective et l’odeur des tilleuls (cette fameuse odeur), en arrière plan jusqu’à présent, réapparaît alors, reprenant le dessus sur les émanations toxiques. Jesus, murmure Idris (en anglais). Katja, qui était restée seule sur le trottoir d’en face, retraverse la rue pour nous rejoindre et, écartant à peine les lèvres, nous dit que la poubelle est pleine de cadavres d’écureuils. Je repense, encore, à hier soir, mais avant d’avoir le temps de s’attarder sur ce qu’elle vient de nous confier, une vive lumière blanche s’abat sur son visage ; Charlie émet un début de son qui lui reste bloqué sur le palais et tous d’un coup les lampadaires se rallument. Les modèles historiques n’ont pas survécu ici. Aucun cri de joie ne retentit. Il fait encore jour, mais cette journée est terminée. Au loin le 4X4 tourne et disparaît enfin ; et je sais, je le sais, que dans mon souvenir les lumières se rallumeront au gré de la descente du véhicule militaire, sagement les unes après les autres, l’ordre rétablit dans la ville.

Les lumières allumées de notre appartement découpent des rectangles radieux dans le crépuscule. On avait trop joué avec les interrupteurs inefficaces pour se souvenir de les laisser en position éteinte. En montant la cage d’escalier, personne ne parle. On devine aux bruits que quelques voisin·e·s sont rassemblé·e·s dans la cour intérieure. Passé la porte, toujours en silence, chacun·e trouve une prise pour brancher son téléphone et s’avachit en attendant la résurrection des appareils. Je dépose la caméra de surveillance, que j’ai gardé contre ma poitrine, avec nos autres trésors. Je fais un signe de la tête tout mou à mes amix, et je file dans ma chambre. Je prends mon temps. J’ai un verre d’eau à la main. Dehors, elle m’était sorti de la tête, mais maintenant, connecté, ça y est : je pense à Bliss. Je branche l’alimentation et mon ordinateur s’allume. En ouvrant mon navigateur, il me propose de reprendre la session. J’accepte. Différents onglets s’ouvrent successivement jusqu’à ce que je retrouve la page blanche, l’architecture de son interface vidée, et cette icône en mouvement qui a hanté ma nuit, gravée dans ma rétine. Quand enfin elle disparaît, indiquant que la page a complété le chargement de ma requête, c’est une autre sorte de vide qui m’apparaît : aucun résultat. Dans les propositions listées par le site, mes yeux dévalent l’écran à la recherche d’un éclat vert, d’une photo d’elle ; je n’en trouve pas. Je fronce les sourcils. Je me lève pour remplir mon verre d’eau.
Mes amix sont répartis entre le sol et le canapé, toustes éclairé·e·s par le halo de leurs écrans, qui semblent pixeliser leurs visages. Je me fais une place entre elleux et vérifie si mon téléphone a suffisamment chargé pour s’allumer. Il va me falloir fouiller.
D’abord les amix de Katja, ceux d’Idris, leurs photos, sur un, deux, trois réseaux – Charlie et Katja enlacées, Katja nue dans les hautes herbes, un émoji soleil sur chaque téton, un atelier à l’école avec une jolie lumière, Berlin Bruxelles Londres Munich Düsseldorf Marseille Bucarest Kiev Manchester Leipzig Accra Dakar Amsterdam Anvers la campagne, une rivière, des coquelicots, repère Google Maps the end of the world, le motif camouflage du U-Bahn, le toit de la SNEER hier soir, Charlie, Charlie, plus loin une photo de Charlie souriante avec une phrase où un mot a été rayé et remplacé par Charlie, I want a Charlie for president, Idris en contre plongée absurde, de retour sur la page principale, rien trouvé, hier soir à l’école, le compte officiel, l’arbuste de l’école fraîchement planté, d’énormes peintures presque monochromes, un amas de câbles, le coucher du soleil, Charlie toujours, la Fernsehturm en quelques gros pixels, les club kids sapés, talons hauts i want to lick your eyeballs, une biennale tous les deux ans et une triennale tous les trois ans, exhibitionnism in bad faith, imagine being anti-socialism and still living in a society U R ON AN ANTIFA WATCHDOG HITLIST, another day (but why?) – les statues soviétiques de Treptower Park, souillées et graffées NO TECH NO COPS NO GODS NO BLISS en rouge et NO INTERNET NO LIFE en noir et une croix gammée en noir aussi mais recouverte de gribouillis jaune, my bébé got cloned un sexgagénaire en harnais de cuir hurlant en allemand do you part!!! illegally download paywalled knowledge!!!! yeah guys not gonna lie i really do feel kinda YOLO un écureuil dans une voiture de sport bleu GET IN LOOSER we’re fucking up Berlin did you see them, did you the stylish kids in the riot, c’est comme ça que volent les oiseaux, you ever use your vacuum sealer for something other than food je scanne les visages dans la foule les images sont courtes vibrantes elles ne persistent pas enjoy yourself because you can’t change anything anyway, Charlie danse, gros zoom, goutte de sueur lente, le hall de l’école plein à craquer et je me vois, seul dans un coin, pas mon meilleur profil, une œuvre encore une œuvre une chemise tachée de chutes de kebab un écureuil démoniaque POV you are a german electrical infrastructure un policier qui matraque un homme à terre et David Bowie do NOT communicate telepathically with me or my spaceship ever again need a multidimensional girlfriend right about now finally a complex apartment complex une voiture et toutes ses vitres éclatées un husky sur le capot Antoine qui pose devant ses toiles Antoine qui danse dans son salon – je suspend l’image, la balaye du regard, la relâche – Antoine avec un écureuil mort dans les mains damn you killed it on the harp regarde elle se débrouille vraiment bien à la harpe ah le vieux pessimisme de Kreuzberg là où est-il passé hein il est où la chancelière qui dit n’importe quoi i love my above hole in the ground now fill it with water un talk show host américain qui parle de nous une vidéo de moi il y a trente seconde Charlie me sourit there’s humming at the end what is it called, this melody, at the end, Dietrich & Horn pris en photo à leur insu un filtre clown sur leurs visages, rien toujours pas de trace, what the establishment truly fears does anybody still make spaghetti eh quelqu’un a faim ou pas vraiment écureuil criminel et the industrial revolution and its consequences have been a disaster for the human race une scène de chaos total briques bouteilles lacrymo canons à eaux chiens matraques molotov jesus christ un molotov Katja tellement trop maquillée un flic inconscient attaché avec du scotch sur le toit de sa voiture encore un putain d’écureuil et encore un écureuil sur la couverture de the thirst for annihilation je commence à en avoir marre je suis écœuré un requin qui en boucle mord dans un gros tube the elite wants you to think it was squirrels but think think un cri qui vient de dehors un écureuil devant son clavier OKAY BOYS WE’RE IN le journal du soir qui annonce les dégâts les blessés et deux morts (au moins) un groupe de touristes français coincés dans un S-Bahn à l’arrêt et ils chantent en français un barbecue au milieu de la route en pleine ville la même vidéo d’un policier qui tabasse un homme à terre cette fois avec le son original et le type se marre do not research do NOT research it would seem that things as they always do in Berlin have calmed down cette ville est une cicatrice no lessons have been learned tragédie d’abord et farce ensuite encore le journal du soir une blonde dont les cheveux débordent de sa cagoule tricotée répète encore et encore comme un robot das Paradies das Paradies, et là enfin, à l’arrière plan, j’inspire, une main cache avec soin les traits d’un visage encadré par des cheveux verts trop brillants ; du bout de l’index j’effleure le visage et rien, en suspend l’image s’agrandit sous mes doigts jusqu’à ce qu’elle devienne trop floue, j’expire, la vidéo se termine dans les hurlements de la foule qui étouffe sous les lacrymos et j’enchaîne avec une publicité pour déodorant écologique. Quand enfin je relève la tête Katja me dit : les écureuils, c’était les putains d’écureuils.
Et je lui réponds : parle-moi de Bliss.

Le jour des écureuils, tiré d' Au revoir collines verdoyantes
de Gabriel René Franjou
Dans le noir j’ai les yeux grands ouverts depuis des heures. Allongé nu sur ma housse sans couette parce que la température n’a pas baissé de la nuit, j’attends le lever du jour et le retour de Charlie. Mon téléphone est mort, et il n’est toujours pas possible de le charger. L’électricité ne fonctionne plus dans tout le quartier, peut-être toute la ville. L’icône en rotation sur la page autrement blanche de mon ordinateur a continué sa révolution jusqu’à ce que l’appareil, vidé, s’éteigne avec un bruit austère. Quand je jette de temps en temps des petits coups d’œil rapides à l’écran encore relevé, l’image du chargement s’y imprime et je détourne le regard avant de me laisser le temps de correctement distinguer mon reflet. Les yeux de nouveau rivés sur le plafond, l’icône persiste au fond de mon crâne, et toujours, rien ne vient.
La nuit faiblit. Elle est chaude et bruyante et longue dans ses dernières heures. Il y a eu de l’agitation dans les rues, les chants les hurlements, la joie et la panique, les crashs et quelques sirènes. Je pense qu’un attroupement massif a dû passer par le voisinage. J’ai entendu un hélicoptère voler très bas, et je me suis demandé si j’étais déjà monté dans un hélicoptère (je ne suis pas certain). Sous un manteau d’obscurité et sans courant, la ville semble s’être libérée – mais aucune visualisation, aucune scène ne me vient. J’espère ne pas trop m’inquiéter pour mes amix mais je m’inquiète quand même un peu. J’espère que Bliss et son amie sont rentrées saines et sauves. L’alcool que j’ai bu cette nuit m’a laissé le ventre contrarié, mais malgré tout, je me sens calme, apaisé, et franchement seul. La sueur me plaque les poils de jambe, je ne bouge plus depuis longtemps. Je ne sais pas quelle heure il est, je n’ai pas de montre.
Je m’attendais à voir la lumière invasive des lampadaires, récemment convertis du gaz à l’électrique, emplir ma chambre avant que ne pointe l’aube, mais ce ne sera pas pour aujourd’hui. L’annonce du retour du jour, le noir fondant au bleu, me rappelle au temps, et après un dernier coup d’œil futile vers mon écran, je ferme méthodiquement les yeux. Quand enfin l’image de la sphère tournant sur elle-même s’efface de mon esprit, quand je commence à sentir mon corps s’enfoncer dans mes draps bleu ciel, alors le blanc se remplit d’une lumière chaude, vive. J’entends une clé tourner dans la serrure industrielle de l’appartement. Entre des éclats de rires essoufflés, Charlie hurle ALLES GUT – quand la porte claque je sens le coin de mes lèvres légèrement remonter et je m’endors comme à chaque fois bercé par l’image des flammes qui brûlent à l’autre bout du monde, et c’est comme si elles avaient toujours été là.

Je dors peu, le jour me dérange. Je ne m’attarde pas trop au lit, et en me levant, j’appuie sans espoir sur l’interrupteur, haut-bas-haut-bas. Inutile. Je tente d’allumer l’ordinateur, qui ne réagit pas non plus. Une montée de panique aiguisée me reste dans la gorge ; elle passe vite. Je me faufile sur la pointe des pieds dans l’espace commun. Katja et Idris, et Charlie et Shen (Shen est l’une des amantes de Charlie) dorment toustes sur le canapé ou aux alentours. Je reste un petit moment à les regarder, debout en me positionnant exprès pour que les rayons de soleil frappent ma nuque. Quelle vie, je me dis. Je décide de leur cuisiner des œufs brouillés, mais en ouvrant le placard pour attraper une poêle je renverse tout et je les réveille. De toute façon la cuisinière ne fonctionne pas non plus. Au final, c’est Idris qui prépare le petit-déjeuner.
Je sers du jus de fruit – tiède – à tout le monde et mes amix me racontent leur nuit. Quand le son s’est subitement éteint dans le club, Charlie a continué à danser, mais Katja et Idris ont senti que quelque chose n’allait plus. Dans l’obscurité totale, le désarroi a vite gagné les animaux nocturnes quand iels se sont rendu compte qu’iels ne captaient plus de réseau sur leurs téléphones. Les gens forcés à quitter les différents clubs se sont retrouvés dehors, défoncés et interloqués, et plusieurs petits groupes surexcités se sont formés. Idris a été absorbé par et s’est perdu dans l’un d’eux, Charlie a croisé Shen ; assez vite, la Polizei a encerclé un groupe de festifs rassemblés dans l’inquiétant terrain vague aux alentours de cet amas de clubs. Idris, Antoine et deux trois autres ont été retrouvés plus tard plus loin devant Treptower Park. Ils étaient aux côtés d’au moins trois blessés, dont l’un qui saignait profusément de l’arcade sourcilière et un autre qui disait avoir deux orteils brisés. Du parc en question émanait une aura de chaos total, dionysiaque, chthonien, raconte Charlie, les yeux scintillants.
Le récit du reste de leur soirée, je ne l’écoute que d’une oreille ; en suivant le doigt pointé d’Idris jusqu’à un coin de l’appartement je découvre quelques modestes trophées : trois caméras de surveillance arrachées, une lumière de chantier, et un tas de roses déjà fanées (Shen a un pétale encore pris dans ses longues boucles noires et Charlie une infime incision au pouce). Je prends avec ma dernière gorgée de jus trois pilules : zinc, vitamine C, et mon médicament. Les verres sont vidés, l’histoire est terminée, mes amix sont sains et saufs. Je me lève de ma chaise, sans raison particulière. Petit silence. Je leur dis que pour ma part, je suis resté immobile dans mon lit toute la nuit. Je ne pose aucune question sur Bliss. À l’unanimité, nous décidons de passer la journée dehors et de profiter du bordel du soleil de la liberté. Détox, baby, détox, me dit Charlie ; KEIN INTERNET, ajoute Katja. Pas le choix, je réponds. Je suis prêt.
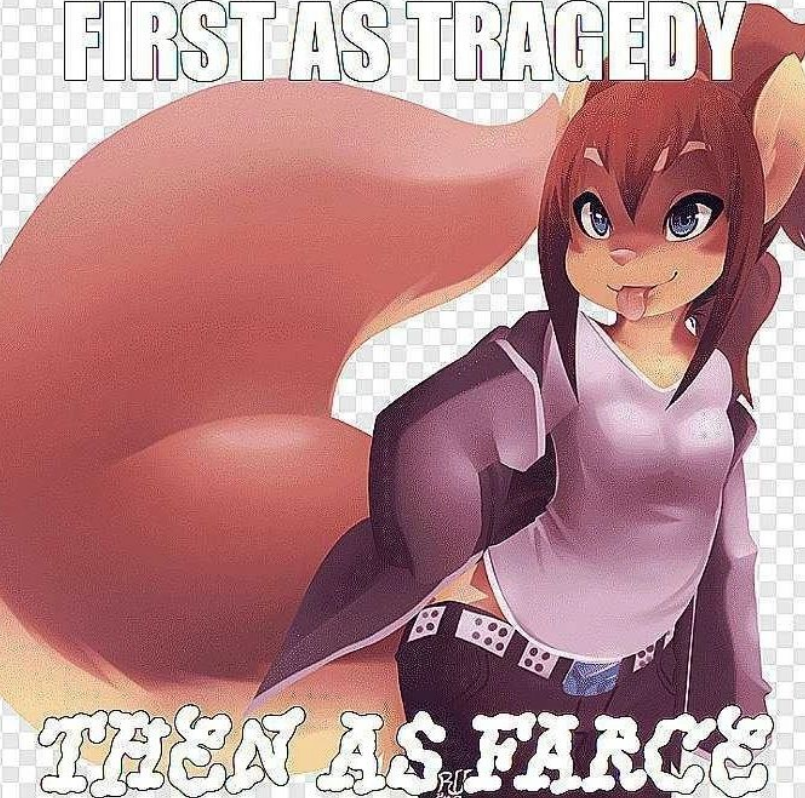
Au bout de sa redescente vers l’asphalte ma semelle écrase un énorme tesson de verre. Le bruit me fait peur mais je ne me suis pas fait mal. On court, on fuit le nuage de lacrymo et on rigole bruyamment ; on s’entend à peine au-dessus du bruit ambiant. Les gens sont en joie et la Polizei commence à s’énerver. C’est le soir, il fait encore jour, et tout le monde est dans la rue. Les vitrines de Mitte ont volé en éclat la nuit passée et les débris jonchent le sol, c’est le jour le plus chaud de l’année, ça sent le caoutchouc fondu et la crème solaire. On s’est bien amusé. On en a assez maintenant, et l’on raconte que l’armée était arrivée dans certains quartiers. Alors on rentre.
Une fois éloigné·e·s du chaos urbain, on se regarde toustes, pour s’assurer que tout le monde est là et que tout le monde va bien. Toustes habillé·e·s de noir (au cas où), le dos trempé, mais indemnes, on se prend dans les bras et l’odeur de nos sueurs nous chatouille. On rigole, on tousse, Idris a les yeux et les joues humides (il s’approche toujours trop près). Ici au centre, la Polizei monte la garde devant les magasins et les banques, et nous étions à un rassemblement pas loin d’Alexanderplatz où un groupe de jeunes slaves chantaient et distribuaient de la nourriture et de l’eau. Il y a vingt minutes on a vu un ensemble d’enthousiastes déguisé·e·s en animaux qui couraient et hurlaient dans les rues, et cinq minutes plus tard la Polizei a chargé et voilà, on a fui. Je me dis, absurde, tout cet accoutrement, par cette chaleur, les bottes, le casque, cette armure. Et puis cet entrain dans la violence, cet excès de zèle sous ce soleil, comment est-ce possible ? Les festivités touchent à leurs fins. On rentre, lentement, en traînant des pieds, malgré le speed que prennent Katja et Idris en plongeant leur clé dans un invraisemblable pochon en plastique vert. Charlie et Shen, elles, tournent encore à l’amphétamine de qualité pharmaceutique que le jumeau de Shen sait se procurer sur le web – elle offre une sensation plus propre et moins intense. Le chemin est long, vraiment long mais pas désagréable pour autant, et je semble flotter. Je me sens léger sans le poids de mon téléphone pour occuper ma poche (je l’ai laissé à la maison exprès), sans mes clés aussi (elles, je les ai oubliées).
On traverse la ville sale, plus sale que jamais (canettes vides, liquides mystère, flyers fluorescents, et ainsi de suite). On croise des groupes d’adolescent·e·s maquillé·e·s avec expertise et délibérément détendu·e·s, des familles promenant leurs enfants, un SUV Mercedes rongé par d’hésitantes flammes, un couple de cinquantenaires en lunettes de soleil assorties se tenant la main, une quantité notable de graffitis encore dégoulinants, des chiens difformes jouant à se battre, un arbuste déraciné (pincement au cœur). Certain·e·s riverain·e·s ont installé devant chez elleux des stands de rechargement à l’aide de générateurs de secours. Les quelques antennes de relais satellite installées en ville sont toutes hors-service – on ne sait pas ce qui s’est passé, mais cela ressemble à du sabotage. Si l’atmosphère paraît moins épaisse, allégée de son brouillard électromagnétique, l’air reste saturé d’odeurs agressives exacerbées par le soleil : la capsaïcine des lacrymos, les divers composés organiques volatiles de la peinture en aérosol, les ordures, le caoutchouc fondu toujours, et de vagues effluves de chaire carbonisée. Les habitant·e·s observent l’agitation depuis leur balcon, sirotant bières ou, plus rarement, du vin. Les lampadaires sont tous éteints. Je me demande si le Sénat de Berlin a ici aussi déjà achevé la reconversion des lampes à gaz historiques en électrique. Je me demande si, à l’heure qu’il y est, à cette période de l’année, ils devraient être allumés.
Au pied des tilleuls de Kreuzberg quantité d’objets, de détritus ou d’artefacts perdus ont été déposés, formant des tas hybrides et absurdes. Les gens continuent d’y prendre et laisser des trucs, dans un va-et-vient calme mais constant. Les tas ne réduisent jamais. Je reconnais les contours, mais je suis incapable de nommer un seul objet. Une masse informe, une bouillie de signes ; et je me dis, de nouveau, comme tous les jours : le monde est plein d’objets, plus ou moins intéressants, je ne souhaite pas en ajouter davantage. Mais je m’extrais de la trajectoire de notre groupe pour aller déposer sur un des tas la bouteille en verre, vide, qui contenait la boisson trop sucrée que j’ai bue trop vite. Un rayon de soleil (le soleil bas dans le ciel maintenant) atteint ma pupille et au pied de l’amas, l’intermédiaire qui reflète la lumière, seul objet autour de moi qui m’apparaisse définissable : une caméra de surveillance, immaculée, et dont les câbles ont été soigneusement sectionnés. Je la ramasse et retourne vers mes amix en la serrant contre ma poitrine, croisant Katja qui elle, en grognant, ramasse ma bouteille en verre et va la déposer de l’autre côté de la rue au pied d’une poubelle qui déborde déjà. Je leur dis : pour votre collection, iels rigolent, j’ai l’impression d’aider. C’est plutôt plaisant d’avoir passé la journée entière dehors. Je me souviens m’être dit, hier soir, que la nuit serait spéciale ; elle a dû infuser ses promesses à la journée d’aujourd’hui : une journée spéciale. Je me demande si cela ne tient qu’à l’absence d’internet, puis je me dis que je ne serai tout de même pas fâché de retrouver le réseau. Et je me dis qu’on peut aussi passer des journées spéciales sur internet. Faut bien y croire, puisque c’est ma vie. Quelle vie, je me dis. Shen dit qui veut du speed ? Personne n’en a envie, cette fois. Une bouteille d’eau circule entre nous, la chaleur fait son effet. Je bois par petites gorgées, comme on me l’a appris.
Un bruit de moteur, anormal, nous fait tourner la tête. Les promeneurs se taisent, quittent la rue pour rejoindre le trottoir, et le grondement de l’énorme 4X4 militaire qui descend lentement l’avenue emplit le soir. Les jeunes soldats qui l’occupent, bronzés, rasés, boutonneux, fixent tour à tour chaque personne qu’ils dépassent. Ils agrippent leurs armes. Les pneus du côté droit laissent derrière eux une mince coulée brune, qui pourrait aussi bien être de la boue, de la merde ou du sang. L’odeur d’essence, surpuissante, me donne la nausée. Le véhicule roule si lentement qu’il semble parader sur un tapis roulant, le genre qu’on voit dans les couloirs d’aéroports ; ça lui confère une aura solennelle mais brutale, qui suinte l’autorité. Tout à fait l’idée que je me fais de tout ce qui concerne le domaine militaire. En un instant trop étiré, le 4X4 rétrécit au fond de la perspective et l’odeur des tilleuls (cette fameuse odeur), en arrière plan jusqu’à présent, réapparaît alors, reprenant le dessus sur les émanations toxiques. Jesus, murmure Idris (en anglais). Katja, qui était restée seule sur le trottoir d’en face, retraverse la rue pour nous rejoindre et, écartant à peine les lèvres, nous dit que la poubelle est pleine de cadavres d’écureuils. Je repense, encore, à hier soir, mais avant d’avoir le temps de s’attarder sur ce qu’elle vient de nous confier, une vive lumière blanche s’abat sur son visage ; Charlie émet un début de son qui lui reste bloqué sur le palais et tous d’un coup les lampadaires se rallument. Les modèles historiques n’ont pas survécu ici. Aucun cri de joie ne retentit. Il fait encore jour, mais cette journée est terminée. Au loin le 4X4 tourne et disparaît enfin ; et je sais, je le sais, que dans mon souvenir les lumières se rallumeront au gré de la descente du véhicule militaire, sagement les unes après les autres, l’ordre rétablit dans la ville.

Les lumières allumées de notre appartement découpent des rectangles radieux dans le crépuscule. On avait trop joué avec les interrupteurs inefficaces pour se souvenir de les laisser en position éteinte. En montant la cage d’escalier, personne ne parle. On devine aux bruits que quelques voisin·e·s sont rassemblé·e·s dans la cour intérieure. Passé la porte, toujours en silence, chacun·e trouve une prise pour brancher son téléphone et s’avachit en attendant la résurrection des appareils. Je dépose la caméra de surveillance, que j’ai gardé contre ma poitrine, avec nos autres trésors. Je fais un signe de la tête tout mou à mes amix, et je file dans ma chambre. Je prends mon temps. J’ai un verre d’eau à la main. Dehors, elle m’était sorti de la tête, mais maintenant, connecté, ça y est : je pense à Bliss. Je branche l’alimentation et mon ordinateur s’allume. En ouvrant mon navigateur, il me propose de reprendre la session. J’accepte. Différents onglets s’ouvrent successivement jusqu’à ce que je retrouve la page blanche, l’architecture de son interface vidée, et cette icône en mouvement qui a hanté ma nuit, gravée dans ma rétine. Quand enfin elle disparaît, indiquant que la page a complété le chargement de ma requête, c’est une autre sorte de vide qui m’apparaît : aucun résultat. Dans les propositions listées par le site, mes yeux dévalent l’écran à la recherche d’un éclat vert, d’une photo d’elle ; je n’en trouve pas. Je fronce les sourcils. Je me lève pour remplir mon verre d’eau.
Mes amix sont répartis entre le sol et le canapé, toustes éclairé·e·s par le halo de leurs écrans, qui semblent pixeliser leurs visages. Je me fais une place entre elleux et vérifie si mon téléphone a suffisamment chargé pour s’allumer. Il va me falloir fouiller.
D’abord les amix de Katja, ceux d’Idris, leurs photos, sur un, deux, trois réseaux – Charlie et Katja enlacées, Katja nue dans les hautes herbes, un émoji soleil sur chaque téton, un atelier à l’école avec une jolie lumière, Berlin Bruxelles Londres Munich Düsseldorf Marseille Bucarest Kiev Manchester Leipzig Accra Dakar Amsterdam Anvers la campagne, une rivière, des coquelicots, repère Google Maps the end of the world, le motif camouflage du U-Bahn, le toit de la SNEER hier soir, Charlie, Charlie, plus loin une photo de Charlie souriante avec une phrase où un mot a été rayé et remplacé par Charlie, I want a Charlie for president, Idris en contre plongée absurde, de retour sur la page principale, rien trouvé, hier soir à l’école, le compte officiel, l’arbuste de l’école fraîchement planté, d’énormes peintures presque monochromes, un amas de câbles, le coucher du soleil, Charlie toujours, la Fernsehturm en quelques gros pixels, les club kids sapés, talons hauts i want to lick your eyeballs, une biennale tous les deux ans et une triennale tous les trois ans, exhibitionnism in bad faith, imagine being anti-socialism and still living in a society U R ON AN ANTIFA WATCHDOG HITLIST, another day (but why?) – les statues soviétiques de Treptower Park, souillées et graffées NO TECH NO COPS NO GODS NO BLISS en rouge et NO INTERNET NO LIFE en noir et une croix gammée en noir aussi mais recouverte de gribouillis jaune, my bébé got cloned un sexgagénaire en harnais de cuir hurlant en allemand do you part!!! illegally download paywalled knowledge!!!! yeah guys not gonna lie i really do feel kinda YOLO un écureuil dans une voiture de sport bleu GET IN LOOSER we’re fucking up Berlin did you see them, did you the stylish kids in the riot, c’est comme ça que volent les oiseaux, you ever use your vacuum sealer for something other than food je scanne les visages dans la foule les images sont courtes vibrantes elles ne persistent pas enjoy yourself because you can’t change anything anyway, Charlie danse, gros zoom, goutte de sueur lente, le hall de l’école plein à craquer et je me vois, seul dans un coin, pas mon meilleur profil, une œuvre encore une œuvre une chemise tachée de chutes de kebab un écureuil démoniaque POV you are a german electrical infrastructure un policier qui matraque un homme à terre et David Bowie do NOT communicate telepathically with me or my spaceship ever again need a multidimensional girlfriend right about now finally a complex apartment complex une voiture et toutes ses vitres éclatées un husky sur le capot Antoine qui pose devant ses toiles Antoine qui danse dans son salon – je suspend l’image, la balaye du regard, la relâche – Antoine avec un écureuil mort dans les mains damn you killed it on the harp regarde elle se débrouille vraiment bien à la harpe ah le vieux pessimisme de Kreuzberg là où est-il passé hein il est où la chancelière qui dit n’importe quoi i love my above hole in the ground now fill it with water un talk show host américain qui parle de nous une vidéo de moi il y a trente seconde Charlie me sourit there’s humming at the end what is it called, this melody, at the end, Dietrich & Horn pris en photo à leur insu un filtre clown sur leurs visages, rien toujours pas de trace, what the establishment truly fears does anybody still make spaghetti eh quelqu’un a faim ou pas vraiment écureuil criminel et the industrial revolution and its consequences have been a disaster for the human race une scène de chaos total briques bouteilles lacrymo canons à eaux chiens matraques molotov jesus christ un molotov Katja tellement trop maquillée un flic inconscient attaché avec du scotch sur le toit de sa voiture encore un putain d’écureuil et encore un écureuil sur la couverture de the thirst for annihilation je commence à en avoir marre je suis écœuré un requin qui en boucle mord dans un gros tube the elite wants you to think it was squirrels but think think un cri qui vient de dehors un écureuil devant son clavier OKAY BOYS WE’RE IN le journal du soir qui annonce les dégâts les blessés et deux morts (au moins) un groupe de touristes français coincés dans un S-Bahn à l’arrêt et ils chantent en français un barbecue au milieu de la route en pleine ville la même vidéo d’un policier qui tabasse un homme à terre cette fois avec le son original et le type se marre do not research do NOT research it would seem that things as they always do in Berlin have calmed down cette ville est une cicatrice no lessons have been learned tragédie d’abord et farce ensuite encore le journal du soir une blonde dont les cheveux débordent de sa cagoule tricotée répète encore et encore comme un robot das Paradies das Paradies, et là enfin, à l’arrière plan, j’inspire, une main cache avec soin les traits d’un visage encadré par des cheveux verts trop brillants ; du bout de l’index j’effleure le visage et rien, en suspend l’image s’agrandit sous mes doigts jusqu’à ce qu’elle devienne trop floue, j’expire, la vidéo se termine dans les hurlements de la foule qui étouffe sous les lacrymos et j’enchaîne avec une publicité pour déodorant écologique. Quand enfin je relève la tête Katja me dit : les écureuils, c’était les putains d’écureuils.
Et je lui réponds : parle-moi de Bliss.

